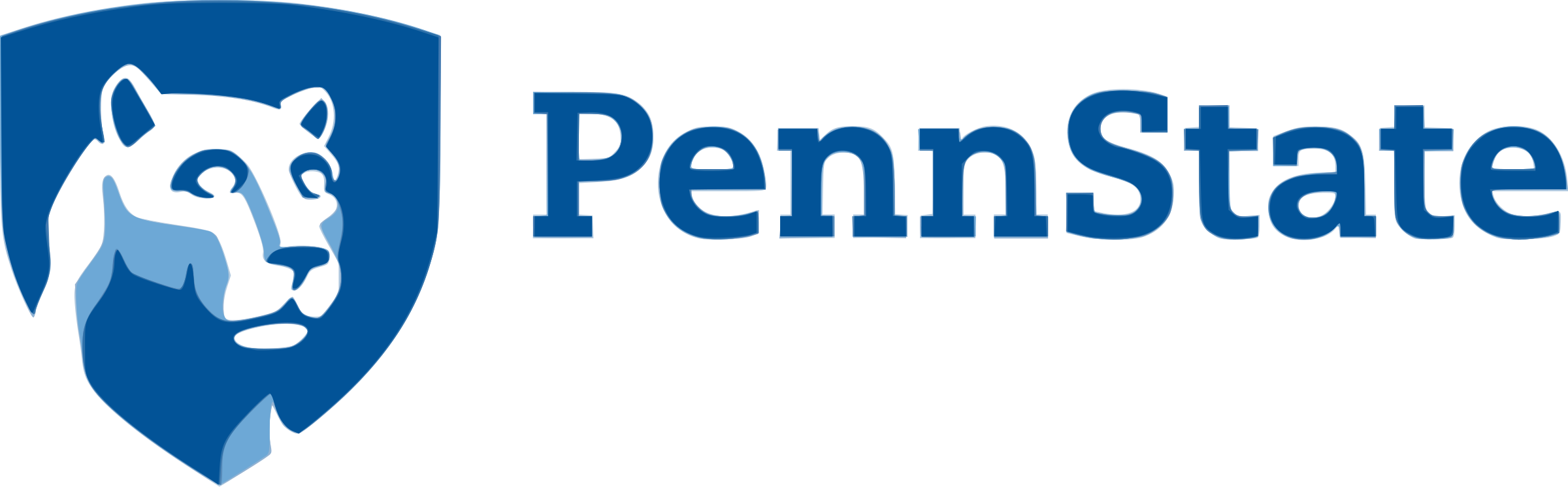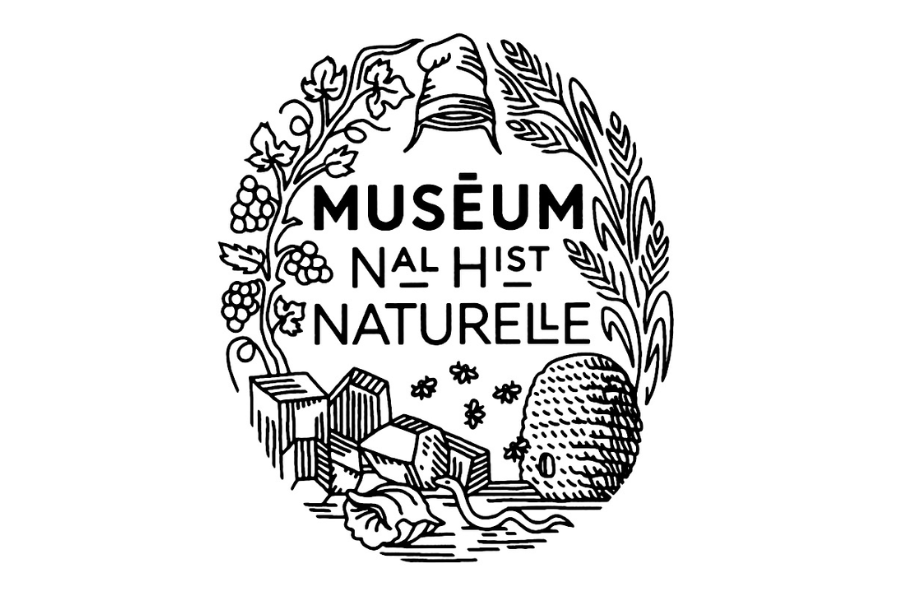Accueil > Leviers d’action > La thèse One Health : Blé tendre sur sol vivant
La thèse One Health : Blé tendre sur sol vivant
Pour une Agriculture du Vivant, entourée de ses partenaires (recherche, finance, technique), a mené une étude sur le modèle « One Health » (« Santé Unique ») auprès de 44 agriculteurs de la façade ouest atlantique de la France afin d’étudier les impacts de l’agriculture de conservation des sols sur la santé des sols, des cultures et sur la qualité des grains, par rapport à l’agriculture dite « conventionnelle ».

Le contexte de l'étude
De façon théorique les liens entre les modes de production agricole, l’environnement, les Hommes et les animaux ont été démontrés par la recherche au travers du concept “One Health”. Parmi les types d’agriculture, l’agroécologie, ou l’agriculture régénératrice aurait des effets positifs sur la santé unique, au travers de ses bénéfices environnementaux ainsi qu’a priori, pour ceux sur la qualité des aliments produits.
Si ce concept a été démontré en théorie, en pratique, peu d’études ont tenté de le faire sur la base de données de terrain.
Cette thèse a été développée afin de proposer une démonstration, sur la base de données de terrain, des liens et des effets des modes de production agricole sur l’environnement, les Hommes et les animaux. Pour ce faire, deux modes de production agricole contrastés ont été sélectionnés : l’agriculture de conservation des sols (ACS), un exemple de pratique agroécologique qui, au travers de ses trois piliers (utilisation de couverts végétaux, non labour, diversification des rotations) se présente comme un mode de culture prometteur pour maximiser les effets positifs sur la santé unique, et l’agriculture « conventionnelle », souvent identifiée comme le mode de culture principal et ayant des externalités négatives sur la santé de l’environnement, des animaux et des Hommes.
Le blé tendre d’hiver a été sélectionné comme culture de référence pour cette étude, puisqu’il constitue la céréale la plus cultivée et la plus consommée en France et en Europe, participant de ce fait à une part importante du régime alimentaire des humains et des animaux d’élevage.
Le cadre de l'étude
Le réseau d’expérimentation à la ferme a été défini à l’automne 2021 et est composé de 22 binômes d’agriculteurs, chez qui les parcelles d’étude ont été suivies pendant les campagnes de cultures 2022 et 2023 dans le Centre-Ouest de la France : Charente (16), Charente-Maritime (17), Indre-et-Loire (37), Maine-et-Loire (49), Deux-Sèvres (79) et Vienne (86).
Chaque binôme se composait d’un agriculteur pratiquant l’ACS depuis 5 à 30 ans, et d’un agriculteur conventionnel pratiquant un travail du sol régulier. Les binômes ont été sélectionnés via, notamment, des critères de proximité géographiques et de conditions pédo climatiques similaires, afin de pouvoir comparer les effets des pratiques agricoles sur la santé des sols de façon équitable et comparable. Les parcelles concernées ont par ailleurs été cultivée avec la même variété de blé tendre, afin de permettre la comparaison objective des composantes nutritionnelles.
Cette étude, menée entre 2021 et 2024 a été rendue possible grâce à l’investissement d’un grand nombre de partenaires :
- Pour le soutien financier : l’association Pour une agriculture du Vivant ainsi que le groupe Nutrition & Santé, Valorex, Gaïago et la fondation Pour un autre monde .
- Pour le soutien technique : Chambres d’agriculture de Nouvelle Aquitaine (Olivier Guérin, Sébastien Minette), de la Vienne (François Périssat, Christine Archenault, Olivier Pagnot) et des Deux-Sèvres (Florent Abiven).
- Pour la recherche : Quatre collaborations ont été établies au cours du projet, pour investiguer plus en détail des questions spécifiques (Auréa Agrosciences, The Pennsylvania State University, Minoterie Girardeau, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris). La supervision scientifique a été opérée par Jean-Pierre Sarthou (INP AgroToulouse/Centre de Recherche pour la Biodiversité et l’Environnement) et Olivier Husson (CIRAD).
Cette thèse a participé à la formation de quatre étudiants qui ont apporté leur soutien au travail de terrain et d’analyse, en participant aux campagnes de terrain (Océane Grudé et Cannelle Frémont), au traitement d’échantillons (Kauê Barbosa) ou à l’analyse d’échantillons au laboratoire (Emma-Alice Riffé).


Les objectifs
La thèse menée poursuivait deux grands objectifs :
- Contribuer à combler une lacune de recherche sur l’étude des modes de culture sur le sol, les plantes, la production et le modèle “One Health” pour démontrer sur le terrain, en conditions réelles, des liens entre pratiques agricoles, santé des sols et des plantes et qualité de la production agricole
- Contribuer à l’amélioration méthodologique des recherches systémiques selon l’approche “One Health” appliquées à l’agronomie pour permettre et faciliter la réplication d’études similaires et développer la recherche agronomique à la ferme
Les étapes
Automne 2021 : Montage du réseau d’agriculteurs
Les agriculteurs ACS ont été sélectionnés via des réseaux d’agriculteurs préexistants (ex : APAD, AGROSOL en Vienne, SOL VIVANT dans les Deux-Sèvres), qu’ils soient débutants ou pionniers en agroécologie. Parallèlement, les agriculteurs conventionnels ont été sélectionnés sur des critères de proximité géographique, de contexte pédoclimatique identique et de pratiques agricoles incluant un travail du sol régulier et un recours limité à la couverture végétale.
Hiver 2022 : Mesure d’Indices de Régénération
Ces mesures d’Indices de Régénération (IR GCPL V2.1), menées au début du projet, ont permis de valider la robustesse de l’échantillonnage du réseau d’agriculteurs en confirmant que les agriculteurs en ACS l’étaient bien (IR>60) tout autant que les agriculteurs en conventionnel (IR<45). Elles ont également montré que les groupes ACS et CONV regroupaient toute une gamme de pratiques plus ou moins agroécologiques, avec des chevauchements entre groupes possibles.
Hiver 2022 - Entretiens complémentaires sur les pratiques agricoles
Ces entretiens ont été mené auprès de tous les agriculteurs sur les 5 années précédentes. Ils ont permis d’obtenir des données fines sur les trajectoires des pratiques agricoles pour mieux évaluer leurs impacts sur la santé des sols et la qualité de la production, ainsi que les performances économiques et environnementales des systèmes. Cette fine connaissance de la pratique agricole constitue le socle scientifique nécessaire pour mener l’étude.
Printemps-Eté 2022 - Phase de terrain (prélèvements et analyses)
Les prélèvements (sols, grains, plantes) sur les parcelles ont été réalisés afin de permettre les analyses de la qualité et de la santé via des indicateurs reconnus scientifiquement et, certains, plus récemment développés, pour démontrer les impacts des pratiques agricoles sur le sol et le grain. (Tests aux champs réalisés dans le cadre de l’application de Biofunctool®)



Année 2022-2023 : Reconduction du dispositif
Le principe général de l’étude a été reconduit avec l’ajout d’un volet plante dans les analyses avec la mise en place par certains agriculteurs de bandes non traitées sur leurs parcelles (absence de fongicides, insecticides). L’objectif était d’étudier de manière plus spécifique et dans les deux systèmes, la capacité des plantes à résister aux maladies et aux ravageurs sans l’appui de la chimie.
Fin 2023 et 2024 : Analyse des résultats et mise en perspective par rapport à la littérature existante
Une année consacrée à la compilation des résultats obtenus, aux analyses et à la rédaction du mémoire de thèse avec en parallèle des rencontres et réunions régulières réunissant toutes les parties prenantes du projet (partenaires financiers, agriculteurs, partenaires scientifiques).
Les résultats
Ces deux années de recherche à la ferme ont permis d’identifier des tendances, qui confirment ou questionnent nos hypothèses sur le fonctionnement des sols, et les effets des pratiques culturales sur la qualité des produits et la performance économique, environnementale et sociale des exploitations.
Les résultats qui suivent sont positionnés sur les trois axes du cadre “One Health “, regroupant les effets des pratiques des deux systèmes sur la santé des sols et de l’environnement, la santé des hommes et la santé des animaux. Ces résultats sont présentés en pourcentage d’augmentation ou réduction des valeurs d’indicateurs mesurés en systèmes ACS, comparé aux systèmes conventionnels.
Santé des sols et de l’environnement :
- Cycle des nutriments : +15% d’azote total / +35% de magnésium disponible / +48% zinc disponible pour les plantes
- Cycle du carbone : + 15% du taux de matière organique et +12% de respiration du carbone (via les microorganismes du sol)
- Biologie du sol : +14% d’organismes vivants dans les sols (carbone microbien)
- Risque d’érosion : 18% meilleure stabilité de surface du sol
- Dépendance aux énergies fossiles : -33% de consommation de gasoil, diminution de la dépendance aux engrais minéraux de synthèse à l’échelle de la rotation (–12% pour l’azote, -56% pour le phosphore, -80% pour le potassium) au profit d’une augmentation des apports de matière organique
- Utilisation de fongicides et insecticides : -36% sur l’année de culture suivie
Globalement, ces résultats montrent une amélioration de la santé des sols en systèmes ACS, grâce à leur meilleure capacité à bien fonctionner. En d’autres termes, les sols ACS assurent plus efficacement le cycle des nutriments, contiennent plus de microorganismes vivants, et sont plus résistants à l’érosion, tout en étant moins dépendants aux intrants de synthèse. L’ACS tendrait donc à promouvoir la fertilité intrinsèque des sols.
Santé des Hommes et des animaux
Aspects nutritionnels et sanitaires du grain :
- +7% phosphore, +5% potassium, 15% ergothionéine (acide aminé antioxydant)
- Pas de perte en protéines
- Pas plus de mycotoxines (champignons toxiques)
- Absence de résidus d’herbicides dans les grains
Performances économiques des systèmes & rémunération des agriculteurs sur l’année de culture du blé tendre :
- Pas de baisse de rendement
- Pas d’augmentation des coûts de production
- Pas de baisse des marges
Social :
- -28% de temps passé au champ
L’ACS se présente comme une alternative intéressante pour maintenir ou améliorer la qualité des productions, tout en maintenant les rendements et les performances économiques des exploitations. A ce titre, elle impacte positivement la santé des Hommes et des animaux via la consommation d’un produit, mais aussi la santé des Hommes qui les produisent (contact avec produits phytosanitaires, temps de travail, rémunération).
Ces résultats doivent toutefois être nuancés : l’augmentation du recours aux herbicides en ACS (+40%) pour lutter contre les adventices reste un problème majeur en systèmes ACS. Certains paramètres étudiés dans l’étude (ex. : gestion de l’eau dans les sols) n’ont pas pu être bien analysés étant donné la difficulté de suivi sur le terrain et, parfois, leur manque d’opérationnalité en conditions réelles. Des résultats intéressants ont été observés sur la partie biologique des sols, toutefois, les limites actuelles de la recherche ne permettent pas d’en faire des interprétations claires et opérationnelles pour les agriculteurs. D’un point de vue nutritionnel, si certaines améliorations ont été notées, nous n’avons pas pu mettre en évidence d’améliorations notables pour certains paramètres d’importance pour la santé, tels que la quantité de protéine, fer, manganèse, polyphénols ou encore antioxydants totaux.
Ces limites de l’études donnent lieu à de nouvelles hypothèses et perspectives de recherche, notamment sur les sujets suivants :
- Réussir à suivre simplement, à coût raisonnable et au champ les effets des pratiques culturales sur la gestion de l’eau par les sols (infiltration, stockage…)
- Mieux comprendre les implications agronomiques de la composition des communautés microbiennes dans les sols pour rendre ces indicateurs exploitables pour les agriculteurs.
- Vérifier l’hypothèse soulevée d’une meilleure qualité de protéines dans les grains de blé, ayant pour conséquence des effets intéressants sur la gestion de la problématique du gluten sur les produits céréaliers.
Pour finir, cette étude démontre l’importance de raisonner sur des pratiques culturales mises en place sur des temps longs (à l’échelle d’une rotation), pour mesurer les effets et bénéfices des différentes pratiques sur l’environnement et la santé. Les résultats observables au champ sont le résultat d’années de gestion par les agriculteurs.
De plus, les pratiques agricoles et les paramètres mesurés peuvent être fortement modulés par le climat. Il est donc nécessaire, pour améliorer la robustesse des résultats de ne pas considérer qu’une année d’étude.



Les perspectives
- Poursuite des échanges avec les agriculteurs du réseau pour promouvoir ces résultats et discuter des pistes prioritaires de recherche qui en découlent
- Poursuite du travail de recherche à la ferme avec le projet « Bourse de Recherche à la ferme », et la création d’un réseau d’agriculteurs pilotes au sein de l’association pour valoriser et déployer les pratiques innovantes à large échelle
- La thèse a étudié une petite partie seulement des aspects économiques ce qui ouvre la voie à des questions sur le modèle économique de la transition et notamment au travers des primes des coûts à la rotation, de la rentabilité de la ferme ou encore des financements à y associer. Des études sont en lancement chez PADV pour analyser plus finement les impacts économiques de la transition au travers des projets COVALO et Pachamama.



Plus d'informations
Liens articles :
Lefèvre, C., Husson, O., Dumora, B., Grudé, O., Lugassy, L., Sarthou, J.-P., 2024. Data from extensive monitoring of agricultural practices, soil health, and wheat grain production in 44 farms in Northwestern France from 2021 to 2023. Data in Brief 57, 111140. https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.111140
Lien Manuscrit de la thèse : https://theses.hal.science/THESES-TOULOUSE-INP/tel-04959160v1